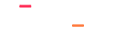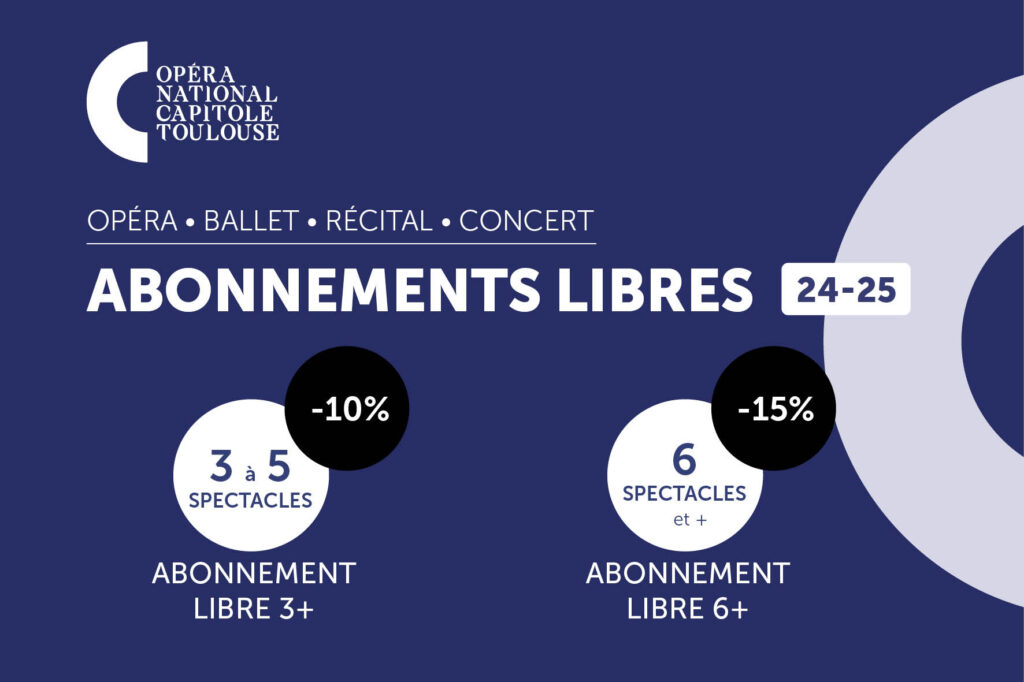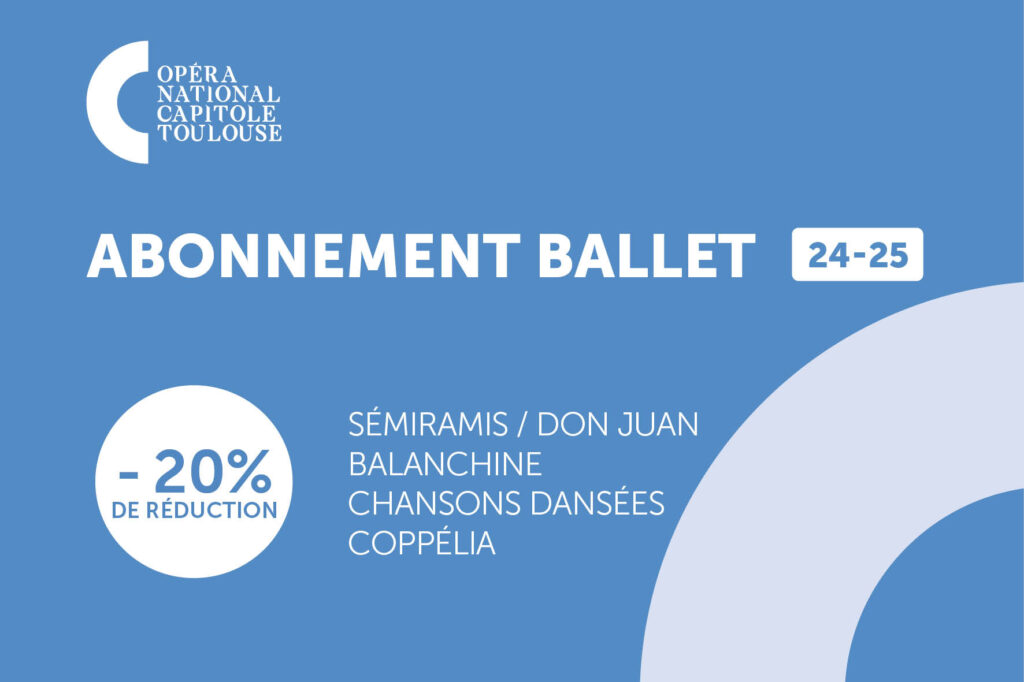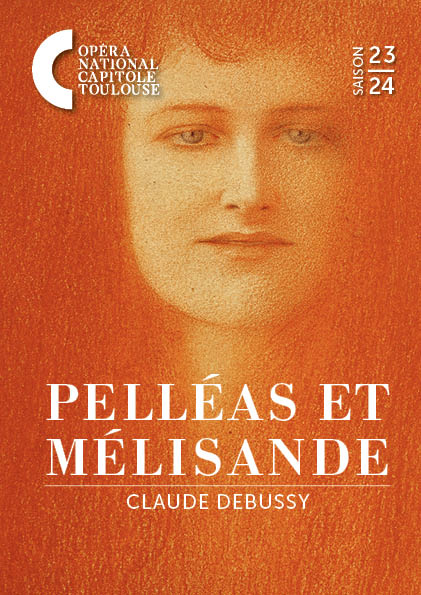Pelléas et Mélisande – Entretien
Questions à… Marc Mauillon Par l’étendue et la singularité de son répertoire, son timbre si reconnaissable et sa diction ciselée, Marc Mauillon occupe une place toute personnelle sur la scène lyrique actuelle. Doué d’une voix…